Comme à Douar Hicher où les affrontements de la mosquée Ennour ont été relayés par les médias, en occultant la violence qui rogne, chaque jour, les territoires de la dignité de ces ségrégués de toujours. Désenchantés, dépossédés du rêve qu’ils ont mis en branle et abandonnés de tous, ces jeunes disent qu’« à 18 ans, ils sont déjà mort » !
Le poids des stigmates
C’est ce que confient des jeunes aux enquêteurs de l’organisation International Alert dont le travail de terrain révèle que nombre d’habitants de ces deux quartiers cumulent, à la fois, la stigmatisation due à leur localisation périphérique et l’exclusion sociale, professionnelle et politique. Dans une interview accordée à Nawaat, Olfa Lamloum, chercheuse et directrice du bureau de l’ONG International Alert à Tunis, évoque les grandes lignes qui se dégagent de cette enquête qualitative et quantitative, la première de cette ampleur à se pencher sur la réalité profonde de ces exclus de la « transition démocratique ».

International Alert a questionné 740 jeunes des deux sexes, âgés de 18 à 24 ans, issus de la population-mère de Douar Hicher et Cité Ettadhamen. Les entretiens se sont basés sur plusieurs entrées : l’origine sociale et familiale, le rapport au quartier, l’itinéraire scolaire et professionnel, le rapport aux institutions, la participation à la vie politique et associative, les croyances religieuses. Six focus groupes ont réunis des profils diversifiés : mères célibataires, jeunes délinquants, jeunes au parcours scolaire accidenté, entrepreneurs, rappeurs, jeunes engagés dans la politique ou dans l’associatif. Problématique, le rapport aux institutions constitue une grande entrée qui a permis aux enquêteurs d’établir une comparaison entre l’avant et l’après révolution. Pour les jeunes de ces quartiers, les choses ont empiré après la révolution. Les services publics se sont dégradés, la corruption a augmenté, le mépris aussi.
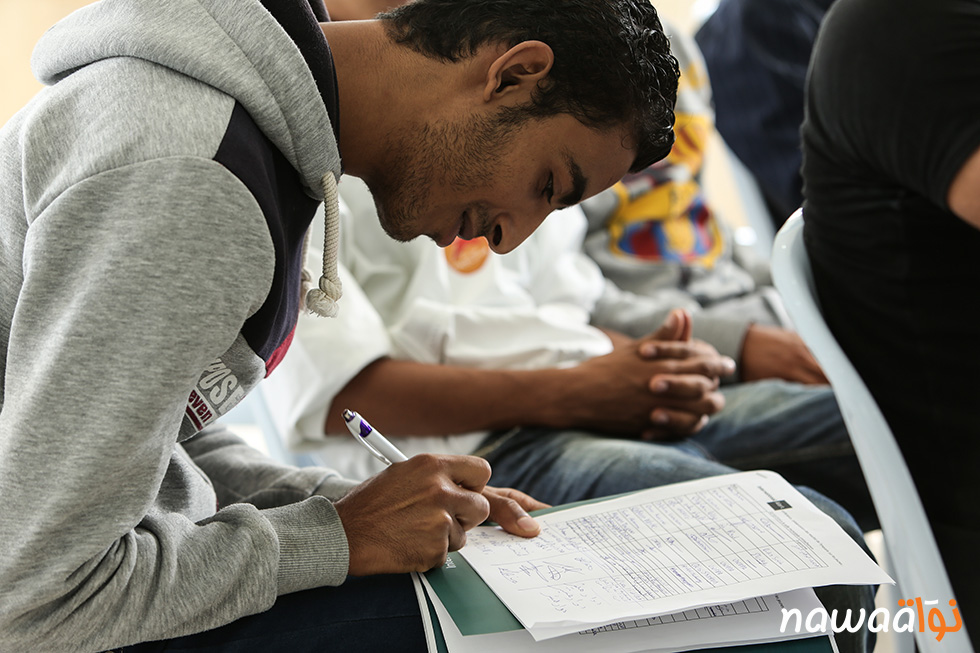
La majorité des jeunes questionnés ont arrêté leurs études au lycée (51.7%), et seulement 27.9% ont poursuivi des études supérieures. L’enquête révèle que le décrochage scolaire est du à une perte de confiance dans les vertus de l’enseignement qui n’est plus, désormais, l’ascenseur social tant rêvé par la génération des pères. Mais comment investir le marché du travail, quand on est stigmatisés à l’extérieur de son quartier ? Ces stigmates et leurs effets négatifs accentuent les difficultés déjà vécues par ces jeunes. Le chômage est « une grande souffrance psychologique », sans doute, pire que toutes les violences notoires ou taboues qui les happent au quotidien. Comme la violence au sein des institutions scolaires que 20% des sondés affirment, effectivement, avoir subi. Une étude réalisée par le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES) a, également, révélé que la violence en milieu scolaire est l’une des causes de l’abandon scolaire volontaire.
De la violence sociale à la violence politique

Pour ces jeunes, le rapport au pouvoir demeure tout aussi problématique, notamment vis-à-vis des politiciens qui ne viennent pas, par hasard, dans ce genre de quartier, mais aussi vis-à-vis de la police. La violence politique, c’est ce qui met en cause l’absence de dignité citoyenne fabriquée par le système économique et social, mais aussi par la nouvelle donne salafiste.

Comme le démontrent les faits, les actes de violence salafiste, dans ces quartiers, sont venus justifier le nouveau tout sécuritaire, tout en banalisant la brutalité de la police qui opte pour un mode d’affrontement direct et un renforcement du quadrillage du territoire. Ce qui met à l’ordre du jour le « projet d’une police de proximité », comme le prouve, d’ailleurs, un reportage réalisé sur ce sujet par Nawaat.

L’un des enjeux de la transition sécuritaire consistant à former une « police républicaine », cet enjeu central s’est avéré difficile, sinon impossible, quand les ordres donnés aux policiers d’utiliser la force les confronte à leurs propres limites. En revanche, une police de proximité est capable de substituer aux traitements des violences quotidiennes, des actions dissuasives. En attendant que cette police idéale atterrisse à Douar Hicher et Cité Ettadhamen, les données de cette enquête sur les jeunes de ces quartiers seront, à n’en pas douter, une excellente base de travail pour les nouveaux élus !




iThere are no comments
Add yours