
Assis paisiblement en face de sa parcelle, Taher savoure cette douce journée de décembre. « Il n’y a qu’ici que je me sens bien », fait-il remarquer. Nous sommes à Nefta, une oasis enclavée entre les étendues salines du Chott el-Jerid et le désert. La parcelle de Taher se trouve dans une sorte de crevasse sous forme de corbeille où coulaient autrefois 152 sources qui alimentaient la totalité de la palmeraie de Nefta. D’où son nom : Ras El Aïn.
Sur sa parcelle, Taher pratique la culture à étages : la strate supérieure est constituée de palmiers dattiers qui jouent à la fois le rôle de parasol et de coupe-vent aux autres arbres. La strate moyenne constituée de différents arbres fruitiers qui permettent de réguler l’humidité de l’air et d’apporter de l’ombre. Enfin, la strate basse, est composée de différentes cultures maraîchères et fourragères. « Il est un des rares à pratiquer la culture à étages, la plupart se contentent des palmiers dattiers », regrette Mariem Essghaier, chef de projet au sein de l’Association de Gestion Durable de l’Oasis de Ras El Aïn (AGDOR).

Des parcelles délaissées
Depuis 2012, l’association s’est lancée dans un vaste chantier : réhabiliter des parcelles délaissées. Sur une surface de 20 hectares, on compte près de 150 parcelles dont la taille varie entre 20 et 2500 m². Dans les années 80, plusieurs facteurs ont amené les agriculteurs à abandonner leurs terres pour trouver du travail ailleurs. En cause : la pénurie d’eau, le morcellement des terrains, l’affaiblissement des sols et la décomposition du système de solidarité traditionnel.
La sécheresse est notre plus grand problème. Nous avons deux chotts qui alimentent l’oasis de Ras El Ain, mais depuis la construction des forages, le niveau de l’eau n’a cessé de baisser, s’inquiète Meriem Essghaier.
Ainsi, face à des nappes souterraines surexploitées et un niveau de pluviométrie de plus en plus faible, l’eau est devenue rare. Aujourd’hui, les agriculteurs irriguent leurs parcelles quatre fois par mois, avec une eau issue de forages.
Alors qu’autrefois, les habitants de l’oasis étaient complètement autonomes dans la gestion des ressources hydrauliques, ils se retrouvent aujourd’hui dépendant de l’Etat et doivent en payer la consommation, explique la jeune chef de projet.

Pourtant, Nefta a connu ses heures de gloire, notamment grâce à Ibn Chabbat qui, au XIIIe siècle a mis au point un système d’irrigation permettant un partage équitable de l’eau. Autogestion et gratuité de l’eau étaient des principes qui régissaient la vie des habitants de l’oasis. Mais la construction des barrages par l’Etat à la fin des années 70 et la généralisation de la technique du forage – souvent, très profond – sont venus bouleversés l’équilibre déjà fragile de la région.
L’eau des nappes fossiles ne se renouvelle pas, ou très peu ! Si on continue comme ça, il n’y aura plus d’eau d’ici quelques années à Nefta,s’alarme Meriem Essghaier.
D’ailleurs, la pénurie d’eau est également liée au choix qu’a fait l’Etat dans les années 80 d’équiper une partie des terrains de la région du Jerid et de les mettre à disposition des agriculteurs afin d’intensifier la production agricole pour limiter l’exode rural. Ces nouvelles palmeraies se retrouvent isolées, car sans village ni vie collective, elles ne constituent plus un écosystème oasien.
« J’ai enfin le sentiment d’être utile »
Face à cette situation, l’AGDOR a encouragé les agriculteurs à réinvestir les parcelles qui sont au cœur de l’oasis. « Lorsque nous avons commencé à travailler ici, elles étaient pour la plupart d’entre-elles en friches et ressemblaient à des décharges », se souvient la jeune femme. Ainsi, à travers des formations et un accompagnement financier, l’association a fait renaître près de 65 parcelles. Taher, retraité de la Compagnie des phosphates de Gafsa, a racheté il y a quelques années une parcelle qui appartenait à ses belles-sœurs. Il a bénéficié du programme de l’association et a ainsi pu planter des palmiers, des arbres fruitiers, cultiver un petit potager et produire ses propres semences. « Cette oasis fait partie de notre patrimoine, nous avons le devoir de la préserver », affirme Taher, fier de nous montrer ce qu’il a planté de ses mains. « Depuis que j’ai acheté cette parcelle, je viens chaque jour, à l’aube, m’en occuper : j’ai enfin le sentiment d’être utile », se réjouit-il. Pourtant, il reste incertain quant au rendement de sa parcelle.
Plus loin, nous rencontrons Mohamed, vêtu d’une blouse bleu marine, les mains encombrées d’un râteau et d’une pioche. Las et mélancolique, cet infatigable agriculteur a été le triste témoin des transformations économiques et sociales de l’oasis.
Ce que fait l’association, c’est bien, mais ça ne sera jamais plus comme avant. Les paysages que j’ai connu, les fruits que j’ai goûté, vous ne connaîtrez rien de cela, fait-il remarquer.
Il en veut à l’Etat de ne pas les soutenir et d’avoir transformé le système d’irrigation traditionnel, mais aussi à la population, d’avoir si facilement délaissé ses terres. « Beaucoup de personnes ont préféré quitter la palmeraie pour un salaire fixe et une vie plus confortable », constate-t-il avec regrets. Et de poursuivre : « Mais en même temps, que pouvaient-ils faire ? Les parcelles sont devenues bien trop petites pour pouvoir faire vivre une famille ». Les difficultés que rencontrent les agriculteurs sont au cœur des discussions. « Ils ont tous une activité professionnelle à côté. Lorsqu’ils s’occupent de leur parcelle, ce n’est pas dans un objectif de rentabilité, mais car il y a un véritable attachement affectif à la terre », note Mariem Essghaier. D’ailleurs, les oasiens préfèrent laisser leurs parcelles en friches plutôt que de les vendre.
Dans notre culture, c’est impensable de vendre son terrain, c’est très mal vu.
Ce n’est qu’un début…
Pour démarrer le projet, l’association a reçu un financement de 120 000 dinars qui leur a permis d’acheter du matériel, de former les agriculteurs, de leur fournir des plants, etc. Mais pour se lancer dans de gros chantiers structurels, il leur faudrait beaucoup plus de moyens. Il y a quelques années déjà, la principauté de Monaco et le Fond Mondial pour l’Environnement, avec le Club Unesco de Nefta, avaient investi près de 350 000 euros pour freiner l’érosion, restaurer les nappes phréatiques et créer un parcours écotouristique. L’association préfère « commencer petit ». En effet, la première étape a été d’établir une relation de confiance avec les agriculteurs, mais aussi avec les institutions locales. « Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisé par le CRDA [Commissariat Régional au Développement Agricole] car nous leur avons fait prendre conscience de certaines problématiques », se félicite Mariem Essghaier. Mais le chemin est encore long pour cette jeune association. En effet, ils souhaiteraient expérimenter avec les agriculteurs des techniques anciennes, développer l’agriculture biologique, créer une communauté d’agriculteurs, etc. Autant de défis à relever afin que l’oasis de Nefta ne meure pas.

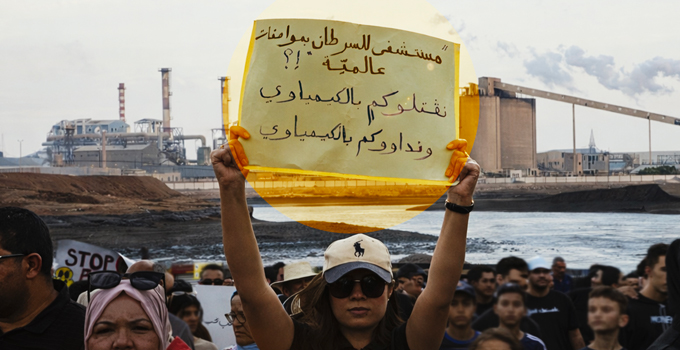


à toute l’équipe, à tous les intervenants sur le site.
mes meilleurs vœux
pour 2016
C’est avec des pareilles initiatives (mais faut-il qu’’elles soient bien soutenues par des capitaux privés essentiellement) qu’on pourra redonner vie, productivité et de l’emploi à nos territoires oubliés/marginalisés. Ces initiatives qu’elles touchent le travail de la terre, refaire vivre certaines industries artisanales, ou tout simplement créer des petits projets d’activité dans différents secteurs de la vie actives. D’ou l’importance d’une véritable décentralisation qui permet aux collectivités locales (communes/intercommunalités/département/régions) d’avoir un pied –une compétences- en matière de développement économique … et cette décentralisation prévoit des départements de projets dans chaque département –wilaya-, afin de faciliter/rapprocher le citoyen de l’administration concernée et lui facilité les démarches administratives et de conseils et d’accompagnement. Depuis le début de la révolution et à plusieurs fois nombreux et nombreuses nous avons largement expliquer cette idées de départements de projets en proximité avec des compétences qui répondent aux besoins des petits investisseurs, nouveaux artisans … la jeunesse en a vraiment besoin et que la jeunesse sans activité … nombreux sont les adultes, les retraités qui souhaitent consacrer une partie de leurs temps pour exercer un emploi indépendant … ça crée de l’emploi, ça crée de la richesse, et ça arrondit les fin des mois … le législateur doit se pencher sérieusement sur cette question… personnellement je crois beaucoup à la possibilité de créer des petits booms économiques locaux … et pour beaucoup les moyens financiers ne manquent pas, mais la situation du pays en général n’est pas à la motivation … lourdeur des démarches administratives, manquent d’accompagnement, voire des centres de formations … et bien évidement la situation sécuritaire joue beaucoup et pousse beaucoup à choisir des activités lucratives pour des gains rapides et qui n’engagent pas sur l’année ou une saison …
Bravo pour cette association, et bon courage. L’année 2016 sera l’année de faire vivre toutes nos oasis.
Bonne et heureuse année 2016
L’initiative de AGDOR à Ras El Ain Nafta , a bénéficié de l’appui du Programme de Micro Financements du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM) sur les Fonds CORE et les fonds d’appui suisse au PMF/FEM-
Cette initiative constitue la continuation des efforts engagés par l’Association locale Club UNESCO Nafta , qui , elle, aussi, a bénéficié de l’appui du PMF/FEM pour la réhabilitation de l’oasis “corbeille de Nafta” – Les fonds du FEM et ceux de la Principauté de Monaco sont venus s’ajouter à ceux mobilisés par le Gouvernement Tunisien à travers le CRDA , le Gouvernorat de Tozeur et la la Municipalité de Nafta – Les apports tunisiens représentent 50% des coûts engagés pour la réalisation des activités sur le site de la “Corbeille” –
Le lobbying des organisations locales de la société civile a été à l’origine de la mobilisation des fonds ( nationaux et internationaux) pour la préservation de l’oasis e Ras El Ain à Nafta
Le chemin qui reste à parcourir est long – Sans une appropriation par les agriculteurs et des propriétaires des parcelles oasiennes de l’approche engagée par AGDOR , les actions engagées et les résultats acquis ( à ce jour) risquent de ne pas être durables
L’oasis de Ras El Ain de Nafta fait partie du patrimoine national, cet écosystème oasien mérite plus d’attention et une prise en considération par les secteurs autres que celui de l’agriculture et en particulier par le secteur du tourisme
Merci pour toutes ces précisions … et bon courage à l’AGDOR.
bonjour,
en Avril 2015, j’ai eu l’occasion de me rendre en Tunisie et plus précisément dans l’oasis de Gabès
j’ai pu leur proposer un programme, original mais très pragmatique, pour sa sauvegarde et même décupler sa surface en moins de 15 ans….