Pour l’Histoire, rappelons que le constitutionnalisme tunisien va être en grande partie influencé par le mouvement de réforme initié en Turquie. Au point de vue institutionnel, les premières réformes significatives interviennent, en effet, dans la capitale de l’empire othomman avec les Tanzimat et notamment par le Hatti-Chérif de Gulkanéh ( 3 novembre 1839 ) et – surtout – par le Hatti Humayoun du 18 février 1856 ([1]). Par ce dernier document, promulgué sous la pression occidentale, le souverain ottoman garantissait des droits fondamentaux tels que la liberté de conscience, la sécurité des biens et des personnes, l’égalité devant la loi, la non discrimination raciale ou religieuse, etc.
Nous retrouvons ces mêmes pressions occidentales – anglaises et françaises – en Tunisie pour inciter le bey à engager des réformes aussi importantes qu’en Turquie ; d’autant plus que le modèle turc semblait être une base satisfaisante à suivre. Le Consul de France en Tunisie n’hésita pas, du reste – et, ce, après avoir obtenu les assurances du bey tunisien d’emboîter le pas à la démarche ottomane ([2]) -, de lui adjoindre un mémorandum dans lequel il manifestait son insatisfaction à l’égard des réformes qui tardaient à voir le jour. Dans ce mémorandum adressé au bey, il écrivit : « dix-huit mois s’étaient déjà écoulés, depuis cette déclaration solennelle et son altesse n’avait encore donné ni à son peuple, ni aux sujets des puissances alliées établies dans ses États, aucune des réformes dont elle avait promis l’adoption » ([3]).
Peu de temps après ce mémorandum, les événements se précipiteront à l’issue de la condamnation à mort d’un juif, Lucien Sfez, pour avoir, en état d’ivresse, renversé avec sa charrette un enfant musulman puis blasphémé et insulté le bey et sa religion ([4]). Cette condamnation à mort, suivie de l’exécution de la sentence, suscita une grande émotion à l’étranger. Cet événement poussa le bey à hâter la mise en place des réformes promises. Dans la hâte générale, le bey nomma « Ibn Abi Dhiaf pour la rédaction du texte de la loi fondamentale de la province tunisienne. Aussitôt, la nuit même, Ibn Abi Dhiaf rédige […] le texte des réformes. Il le soumet, le lendemain à l’appréciation et à l’approbation des membres du gouvernement et aux ‘ulamâ du pays » ([5]). C’est dans ces conditions que fut promulgué, le 10 septembre 1857 ( 20 Mouharram 1274 ), le Pacte Fondamental sous l’appellation arabe du Pacte de ahd el aman ( ère de la sécurité ) par Mohammed Pacha bey, « possesseur du royaume de Tunis ».
Dans ce Pacte, l’empreinte du Hatti Humayoun est plus que manifeste. Car, il s’est agi de proclamer la garantie de certains droits fondamentaux dans le même style que la charte turque. C’est ce qui, du reste, en ressort à la lecture de ses articles I, II, IV et XIII ([6]) :
Le Pacte fondamental a été suivi, peu de temps après, par la promulgation de la première Constitution tunisienne du 26 avril 1861 ([7]). Ladite Constitution, sans préambule, était composée de 114 articles répartis sur 13 chapitres. Cette Constitution s’est caractérisée par sa nature de charte octroyée unilatéralement. Puisque, et ainsi que le souligne Hachemi Jegham, elle : « […] a été arrêtée sans qu’interviennent dans l’opération les habitants du royaume ou leurs représentants. Au regard de la théorie Constitutionnelle, il s’agit là d’un mode autocratique de l’exercice du pouvoir constituant originaire » ([8]).
Tout en reprenant dans ses articles 86, 88, 89, 105, 109 et 114 les garanties déjà prévues par le Pacte fondamental ([9]), la nouvelle Constitution met en place un nouveau régime qui tempère la tradition absolutiste du régime beylical.([10]).
La Constitution de 1861 ne se maintient pas longtemps. L’endettement de la Tunisie, conséquence de la gestion dramatique du ministre Khasnadar, -lequel avait fait de la France le principal créancier du royaume- avait supprimé toute marge de manœuvre. Avec l’augmentation brutale des impôts qui s’en suit, on s’achemine vers de vives révoltes qui vont être à l’origine de la suspension, le premier mai 1864, de la Constitution.
Quelques années plus tard, avec la signature du traité de Ksar Saïd ( Traité du Bardo ) le 12 mai 1881, la Tunisie tombe sous la dépendance de la France qui occupera militairement son territoire en vue du « rétablissement de l’ordre et de la sécurité de la frontière et du littoral » ( article 3 du traité ). Dès lors, la Tunisie patientera jusqu’à la libération avant de refonder son régime politique. Un régime qui devait être une République démocratique (I) mais dont on ne perçoit aujourd’hui, du fait de la constitutionnalisation progressive du potentat présidentiel (II), qu’une République agonisante au sein de laquelle les échos des persécutions raisonnent dans un vide démocratique total.
I. — Le régime républicain du 1er juin 1959
Dès l’autonomie interne, le projet d’une Constitution démocratique représentait la principale priorité. Le 30 décembre 1955, le journal officiel tunisien promulgue un décret beylical instaurant la création d’une Assemblée constituante. Celle-ci, afin de proposer la Constitution de la future monarchie constitutionnelle tunisienne ( article 1 ), sera élue au suffrage universel direct et secret ( article 2 ). Une fois le projet élaboré, il devra recevoir le sceau du monarque qui le promulguera en tant que Constitution du royaume ( article 3 ) ([11]).
La monarchie tunisienne, par le décret du 30 décembre 1955, va signer l’acte de son abolition. Si durant la période coloniale et par souci d’opposer au colon un front uni, la volonté affichée du principal acteur de la scène politique tunisienne — le néo-destour — n’avait pas indiqué son intention d’abolir la monarchie au profit d’une République ([12]), les choses allaient radicalement changer après l’acquisition de l’indépendance ( 20 mars 1956 ). Car, peu de temps après, c’est-à-dire le 25 juillet 1957, la dynastie husseinite sera écartée par le désormais tout puissant Parti Néo-destourien par un véritable « coup d’État »([13]).
L’Assemblée constituante élue sur la base du décret beylical du 29 décembre 1955 ne détenait pas, comme cela a été fort bien analysé par Abdelfattah Amor ([14]), le pouvoir constituant originaire. Elle détenait un mandat dont l’objet était strictement limité à l’élaboration d’une Constitution monarchique. Et c’est, uniquement, en vue de cet objectif qu’elle reçut son mandat du peuple. Or, et bien que détenant un pouvoir constituant dérivé, cela ne l’a pas empêché de faire table rase de l’ordre beylical et de sa légalité. Dans leur résolution du 25 juillet 1957, les constituants, excipant de leur qualité de représentants du peuple, abolissent le régime monarchique, proclament la République et confient au président du Conseil, Habib Bourguiba, le titre de président de la République ([15]).
La légitimité de ce coup de force constitutionnel n’a jamais été mise en doute par la doctrine tunisienne ([16]). Et, comme pour tout coup de force, même légitime, la procédure suivie n’était pas exempte de commentaires relatifs à son illégalité. Mais ce que l’on peut toutefois noter, c’est que cette illégalité de la résolution du 25 juillet 1957 s’atténue si on ne l’apprécie plus comme un acte de la même constituante que celle qui a été instituée par le décret beylical du 29 décembre 1955. En effet, on peut admettre, qu’imperceptiblement pour l’observateur extérieur à l’Assemblée en question, peu avant le 25 juillet 1957, une nouvelle constituante apparaît à l’occasion d’une authentique révolution politique ([17]). Et ce n’est pas parce que cette révolution n’a pas été — comme l’a déjà souligné Abdelfattah Amor —, spectaculaire en raison de l’absence d’effusion de sang, qu’elle n’en sera pas une. Car, il s’agit bien d’une révolution au vrai sens du terme, puisque porteuse d’une transformation radicale de l’ordre politique fondamental qui délaisse la légalité beylicale au profit d’une nouvelle légalité républicaine.
De même, les seuls coups d’État qui s’avèrent illégaux sont les coups d’État qui avortent. Un coup d’État qui réussi est, dans une certaine mesure, toujours légal ; puisqu’il est en même temps porteur de sa propre légalité, soit par une nouvelle interprétation officielle du droit en vigueur— ce que fit Bourguiba pour justifier la démarche de l’Assemblée constituante ([18]) — soit par un nouvel ordre juridique qui légalise a posteriori l’aventure réussie —ce qui nous semble être objectivement le cas de l’instauration de la République en Tunisie.
Cela étant, il n’en reste pas moins que le projet de la constituante a été confectionné par le néo-destour sur les mesures de Habib Bourguiba, lequel avait eu une assemblée intégralement acquise à sa cause. Car, outre le fait que les membres du Parti du « combattant suprême » avaient occupé la totalité des sièges de la constituante ([19]), il y avait eu également « cinq Vice-Présidents de l’Assemblée sur six Vice-Présidents membres de droit du Bureau de la constituante [qui étaient] membres du Bureau politique du néo-destour » ([20]). Cette concentration des partisans de Bourguiba, et notamment de ses plus fidèles lieutenants aux postes clé de la constituante a accouché, en dépit des orientations initiales de l’Assemblée en faveur du régime parlementaire, d’une Constitution présidentialiste à la hauteur du nouveau « père de la nation ». Cette nouvelle Constitution ne fera pas l’objet d’une adoption par voie référendaire, et ce, faut-il le souligner, malgré la transformation du mandat initial de ses auteurs ( lesquels détenaient un pouvoir constituant dérivé et non originaire ).
La Constitution tunisienne de 1959 fera l’objet, par la suite, de nombreuses révisions ([21]). Les plus importantes sont celles de 1975, instituant la présidence à vie de Bourguiba ([22]), de 1976 introduisant des mécanismes parlementaires, celle de 1988 -sous Ben Ali- supprimant la succession automatique à la tête de l’État en cas de vacance de la présidence, mais renforçant, néanmoins, le pouvoir présidentiel([23]), celle de 1995 qui constitutionnalise les attributions du Conseil constitutionnel ([24]), et celle de 1997 qui limite le pouvoir normatif de la chambre des députés en renforçant davantage le pouvoir réglementaire du président de la République ([25]).
La Constitution, telle que promulguée le premier juin 1959 ([26]), institue un régime présidentiel assez classique ([27]). Celle-ci, relativement courte ( 62 articles ), érige, jusqu’en 1976, un système politique basé sur une séparation stricte des pouvoirs. Bien que ce régime fut conçu pour H. Bourguiba ([28]), l’Assemblée nationale, et conformément à la logique d’un système qui devait être multipartisan ([29]), n’était pas particulièrement assujettie au président ([30]). Or, ce qui va manquer justement au développement d’un régime libéral, c’est la suppression, de fait, à partir de 1963 du multipartisme. Dès lors, le Chef de l’État, président à vie du Parti Socialiste Destourien ([31]), en cumulant la présidence de la République avec celle du seul parti présent à l’Assemblée nationale, avait abouti à ce qu’il n’y ait plus de contre-pouvoir en face de lui. De plus, le régime étant axé sur une séparation stricte des pouvoirs, l’Assemblée nationale -nonobstant la docilité naturelle de ses membres à leur chef de parti- n’était pas constitutionnellement en mesure d’exercer une pression vis-à-vis du Chef de l’État, puisque conformément à la logique du régime présidentiel, il n’y avait, de part et d’autre, ni motion de censure, ni droit de dissolution.
Il faut admettre, cependant, que Habib Bourguiba était conscient des dangers que représentait une telle situation. Le 8 juin 1970, après avoir constaté que « l’expérience [révèle] que la concentration du pouvoir entre les mains d’un seul, aussi dévoué soit-il, comporte des risques », il révèle les grandes lignes de la réforme constitutionnelle qu’il envisage([32]). Celle-ci portera, avait-il annoncé, sur « des amendements [qui] rendront le gouvernement responsable devant le président de la République, mais aussi devant l’Assemblée nationale qui est issue du suffrage populaire. Ainsi, il sera loisible à cette assemblée de démettre un ministre ou le gouvernement par un vote défavorable […]. D’autres modifications de la Constitution allégeront les responsabilités qui sont assumées jusqu’ici par le président de la République et par lui seul. […] Après quinze années d’exercice du pouvoir, il est temps de réviser la Constitution pour établir une certaine collaboration entre le Chef de l’État, l’Assemblée nationale et le Peuple » ([33]).
Ces propos du « combattant suprême ([34]) » vont être concrétisés par la réforme constitutionnelle de 8 avril 1976. Celle-ci introduit, tel que voulu par le président tunisien, une inflexion du régime présidentiel par l’adoption de mécanismes normalement inhérents au régime parlementaire dualiste. La révision de 1976 crée un gouvernement à la fois responsable devant l’Assemblée nationale ( article 62 ) et devant le président de la République ( article 59 ). Non sans certaines similitudes avec l’ex-régime algérien de 1963, la nouvelle réforme, de même qu’elle conférait au Chef de l’État le droit de dissoudre l’Assemblée, elle octroyait aux députés le droit de censurer le gouvernement et, par-delà lui, d’obliger le président de la République à démissionner.
De la sorte, la Constitution tunisienne, telle que modifiée en 1976 institue un modèle très singulier, au point d’être relativement déroutant par rapport aux schémas constitutionnels classiques. Puisqu’il s’agit à la fois d’un régime présidentiel mais néanmoins axé sur une séparation souple des pouvoirs (!).
Le nouvel article 63, issu de la révision en question, énonçait que « si au cours de sa première session [et après une première dissolution de l’Assemblée Nationale suite au vote d’une motion de censure], l’Assemblée nouvellement élue adopte une nouvelle motion de censure, dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que celle adoptée par la précédente Assemblée, le président de la République devra présenter sa démission ».
Bien que singulière, cette disposition était somme toute logique étant donnée la nature des fonctions du président de la République qui faisaient de lui l’unique décideur de l’exécutif. L’étendue des pouvoirs de Habib Bourguiba était telle qu’elle devait entraîner une responsabilité politique devant l’Assemblée Nationale. Celle-ci devait avoir la possibilité de remettre en question le mandat du président en l’obligeant à démissionner ; et cela à la suite de deux révocations successives de son gouvernement qui n’est qu’un exécutant.
À cet égard, il faut noter que la révision de 1976 n’a pas transformé le caractère présidentiel du régime. Le gouvernement qui n’avait aucune autonomie, était d’abord « responsable de sa gestion devant le président de la République » ( article 59 ). Cette responsabilité dans « […] la mise en œuvre de la politique générale de l’État, conformément aux orientations et aux options définies par le président de la République » ( article 58 ) impliquait que ce dernier « [pouvait mettre fin] aux fonctions du gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre initiative […] » ( article 51 ). Et vu que le principe de la mise en cause de la responsabilité politique est censé s’appliquer à l’auteur d’une politique et non à ses exécutants, la responsabilité du gouvernement engageait, par ricochet, celle du président lors du vote de deux motions de censure successives ( article 63 ).
Mais, ce schéma institutionnel n’a jamais fonctionné. Du constitutionnalisme tunisien, il n’y avait que la vitrine qui scintillait. Et, était-il possible d’imaginer une mise en échec du « Combattant suprême » par la Chambre des députés qui fit de lui, le 19 mars 1975, le président à vie de la Tunisie ([35]) ? Ce cadre constitutionnel devenait, en raison de la fusion, comme en Algérie, entre le parti et l’État, sans portée démocratique. Et lorsque, enfin, à partir de 1981, le multipartisme refait surface, du moins en droit, il était déjà trop tard pour le « grand naufragé » de remettre en scène une vie politique plus digne, à l’image des institutions constitutionnelles — très perfectibles certes — dont il a doté son pays. Et précisément, c’est cette revalorisation de la vie politique que le peuple tunisien attendait du successeur du « vieux père de la nation».
Zine El Abidine Ben Ali, second président de la République, à peine accédait-il au pouvoir qu’il promet aux Tunisiens, dans la déclaration « retentissante [sic]» du 7 novembre 1987, un authentique virage démocratique auquel, de guerre lasse, le peuple ne croyait plus ([36]). Mais, le désenchantement sera rapide. Car, le « régime de croisière » qui s’installe avec Z. Ben Ali va paradoxalement aggraver le potentat du chef de l’État.
II. — La constitutionnalisation du potentat présidentiel
Le 7 novembre 1987, constatant l’incapacité notoire de H. Bourguiba à exercer le pouvoir, le premier ministre de l’époque, Ben Ali, en vertu de l’article 57 de la Constitution ([37]), s’empare de la magistrature suprême ([38]). Cette prise du pouvoir fut appuyée par la déclaration du 7 novembre 1987 annonçant, entre autres, « une révision de la Constitution […] [qui supprimera] la présidence à vie [et] la succession automatique à la tête de l’État » ([39]). Signalons, cependant, que la présidence à vie de Bourguiba, dont il s’agit, n’était pas la règle mais une exception constitutionnelle aménagée spécialement pour le premier président tunisien, intuitu personae ([40]).
Cela étant, la révision annoncée est votée le 25 juillet 1988 ([41]). Et comme promis, un nouvel article 57 mettra fin à la succession automatique à la tête de l’État en cas de vacance de la présidence ([42]). De même, et en ce qui concerne le mode de désignation du président, un nouvel article 39 va limiter les mandats présidentiels à trois mandats successifs ([43]).
Cependant, si le contenu de cette révision était attendu, et avait satisfait les Tunisiens, il y avait eu, en revanche, une autre modification constitutionnelle très importante et laquelle, malgré son caractère très troublant, touchant à l’équilibre des pouvoirs, avait semblé, à l’époque, passer totalement inaperçue par les médias ([44]). Si bien que l’abrogation de l’ancien article 57, placée dans un contexte bien précis, donne lieu à une interprétation inattendue.
Nous l’avons vu, tout en confirmant le régime présidentiel, voire présidentialiste, la révision de 1976 avait opté pour un rééquilibrage des rapports exécutif/législatif. Or, ce nouvel équilibre des pouvoirs entre un président aux pouvoirs étendus et une Assemblée qui, dans un contexte multipartisan, détient un moyen de pression — la censure présidentielle — a été supprimé.
La révision constitutionnelle du 25 juillet 1988, en abrogeant les dispositions de l’article 63 ancien, a supprimé la responsabilité du président devant l’assemblée. Désormais, quelle que soit l’issue d’un grave et permanent désaccord entre la politique du président de la République et celle de l’Assemblée nationale, soit cette dernière obtempère, soit elle peut être dissoute à l’issue de chaque réélection qui commencerait par le vote d’une motion de censure. Ainsi, le président de la République n’est plus tenu de démissionner à la suite du vote, dans les mêmes conditions, d’une deuxième motion de censure tel que cela fut le cas dans l’article 63 ancien. Le nouvel article 63 disposant, en effet, qu’ « en cas d’adoption par la Chambre des députés d’une deuxième motion de censure à la majorité des deux tiers pendant la même législature, le président de la République peut, soit accepter la démission du gouvernement, soit dissoudre la Chambre des députés » ( article 63-1 ).
Quand bien même l’article 63 nouveau conserve la disposition selon laquelle le gouvernement doit démissionner et en raison du fait que cette procédure n’aboutit plus à l’engagement de la responsabilité du réel auteur de la politique du gouvernement, la démission dudit gouvernement n’a plus de signification politique, puisque ce dernier n’est qu’un exécutant de la volonté présidentielle. De ce fait, le véritable auteur de la politique gouvernementale devient hors d’atteinte. Malgré l’importance initiale des pouvoirs du Chef de l’État, celui-ci, par la révision constitutionnelle de 1988, obtient la pierre d’achoppement d’un pouvoir considérable, sans contrôle réel. Eu égard à ses pouvoirs, la suppression de la responsabilité du Chef de l’État nous paraît d’autant plus inattendue que jamais, avant la révision de juillet 1988, il n’a été question de toucher à cette disposition de l’article 63. Ni les politiques, ni la doctrine n’ont jamais, à notre connaissance, émis la moindre opinion en ce sens. Et, autant dire, qu’à la lecture de la page 1067 du n° 50 du journal officiel tunisien du 26 juillet 1988, la surprise fut totale. En outre, l’on a beau examiner la modification de l’article 63 sous tous ses angles, nous n’en saisissons pas la logique démocratique. Car, faut-il le rappeler, l’accès de Ben Ali au pouvoir devait se solder, conformément à la déclaration du 7 novembre 1987, par une libéralisation du régime et non par son « verrouillage ». En effet, s’il s’agissait d’une libéralisation alors pourquoi avoir… :
— supprimé l’équilibre des pouvoirs institué par la révision de 1976, lequel représentait un garde-fou nécessaire à tout dérapage des orientations du président, surtout lorsque celles-ci se révéleraient liberticides ?
— Pourquoi avoir renforcé les pouvoirs du président tout en supprimant sa responsabilité politique devant l’Assemblée, alors même que cette responsabilité ne représentait aucune contrainte de nature à gêner l’action du président. Puisque l’obligation de démissionner n’intervenait qu’à la suite d’un sérieux blocage institutionnel ( le vote de deux motions de censure dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs )?
— Pourquoi octroyer à un seul homme un tel pouvoir ( quand bien même élu au suffrage universel ) et un tel ascendant ( droit de dissolution ) sur l’Assemblée des représentants du peuple tout en délestant cette dernière du contre-pouvoir qu’elle incarnait ?
— Quels arguments peuvent-ils justifier la mise entre les mains d’un seul homme le destin d’un pays, d’un peuple et de ses institutions sans prévoir la moindre disposition de nature à dissuader et surtout à empêcher, s’il échet, toute entreprise unanimement préjudiciable aux intérêts supérieurs de la nation ?
Assurément, nous ne trouvons aucune réponse pouvant donner un sens à la modification de l’article 63. Un sens autre que celui qui consisterait à réaliser qu’il s’agissait là, dès 1988, d’une démarche tendant à s’emparer le plus efficacement possible de l’appareil d’État et de s’isoler dans la citadelle du pouvoir. Ce que, au demeurant, le reste de la révision confirme et que les futures pratiques du régime illustreront avec éclat.
En effet, s’agissant du reste de la révision, si la modification de l’article 57 précitée était attendue, il n’empêche, toutefois, qu’elle apparaît comme n’étant qu’une simple disposition destinée à « faire le vide » autour du président, et ce, non sans concentrer davantage de pouvoir entre ses mains et sans réduire, par la même occasion, ceux du premier ministre par les dispositions d’un nouvel article 60.
Aussi, convient-il, afin que la réforme de 1988 apparaisse sous sa vraie nature, d’adopter une grille de lecture qui mette en parallèle les trois dispositions principales de la révision :
– L’amendement de l’article 57, fût-il irréprochable sur le plan démocratique, implique par la suppression de la succession automatique à la tête de l’État pour le reste de la législature en cours, l’élimination d’un potentiel rival politique, en l’occurrence le premier ministre ; lequel, au fond, incarnait un vice-président de la République.
— L’amendement de l’article 60 de la Constitution qui énonçait que le premier ministre « […] dispose de l’administration et de la force publique » et qui désormais n’en dispose plus depuis juillet 1988 ( article 60 nouveau ) ([45]), n’est qu’une manifestation objective de la volonté de réduire le poids et l’influence du numéro deux de l’exécutif. Nul mieux que le « tombeur de Bourguiba » n’est à même d’apprécier les risques que représenterait un éventuel « dauphin ».
— Et enfin, la suppression de la responsabilité politique du chef de l’État ( art.63 ) clôt la consolidation des pouvoirs présidentiels qui n’ont d’équivalent désormais que l’immunité de ses actes.
Par la révision constitutionnelle de 1988, l’héritage constitutionnel bourguibiste, dans ce qu’il avait de relativement positif, part en éclat dans un silence assourdissant. Car, est-ce utile de le mentionner, le seul écho relatif à l’aspect inattendu de cette réforme, que nous avons eu, figurait dans un éditorial de Hichem Djaït qui devait paraître au sein de l’hebdomadaire tunisien « Réalitées » du 16 décembre 1988. Dans son éditorial « point d’ombre », l’intellectuel tunisien avait tenté de stigmatiser publiquement la « tendance anti-démocratique profonde [du nouveau régime…] » ([46]). Mais, sa tentative fut veine. Car, le numéro de l’hebdomadaire accueillant l’éditorial fut saisi, sans aucune forme de procès ([47]). Ajoutant à cela, que même la Revue Tunisienne de Droit, laquelle pourtant n’avait pas ménagé, par le passé, le pouvoir bourguibien, a gardé un silence qui tranche avec ses habitudes. Aucun article traitant de la profonde modification des rapports exécutif/législatif n’a été publié en son sein à l’issue de la révision constitutionnelle du 25 juillet 1988.
Ainsi il est évident que la révision constitutionnelle de 1988 s’avère un sérieux retour en arrière. Elle a aggravé la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République tout en supprimant les contre-pouvoirs indispensables à toute démocratie. Et le plus paradoxal dans tout cela, c’est qu’en dépit du fait que la Tunisie avait honni, semble-t-il, le pouvoir —de fait— sans partage de H. Bourguiba, si tôt ce dernier destitué, elle s’est vue offrir la constitutionnalisation de ce pouvoir qui la ramène au temps du beylicat.
Malgré tout ce qui vient d’être évoqué, la confiscation du pouvoir par Ben Ali n’allait pas s’arrêter là. En effet, près de 10 ans après son accession à la tête de l’État, la boulimie du pouvoir va atteindre un palier supplémentaire par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 ([48]). Cette révision constitutionnelle va limiter le pouvoir normatif de la chambre des députés au profit du pouvoir réglementaire accru du président de la République ([49]).
Il convient d’abord de rappeler que contrairement à certains pays, jusqu’en 1997, il n’y avait pas en Tunisie un domaine réglementaire restreignant le pouvoir normatif des députés ([50]). Et, la réforme constitutionnelle de 8 avril 1976 ([51]) qui a énuméré dans les articles 34 et 35 les domaines dans lesquels intervient la loi n’octroyait pas a contrario un domaine réglementaire propre à l’exécutif. Et il faut bien réaliser que la révision constitutionnelle de 1976 avait plutôt pour objet, à travers les articles 34 et 35, la protection du domaine de la loi. Et, du reste, à la question d’un député à cet égard, le premier ministre de l’époque Hédi Nouira avait précisé : « l’objet de l’énumération des articles 34 et 35, institue un domaine du ressort exclusif du parlement ; mais cette exclusivité n’empêche pas le législateur d’intervenir dans d’autres domaines » ([52]). Ainsi, les députés tunisiens peuvaient-ils légiférer dans tous les domaines.
Pour le pouvoir réglementaire du président tunisien, celui-ci découle de la même révision constitutionnelle du 8 avril 1976. L’article 53 de la Constitution dispose que « [le président] exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer tout ou partie au premier ministre ». Le pouvoir réglementaire autonome du président n’est pas soumis au contrôle du juge. En effet, l’article 3 de la loi du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif soustrait les décrets à caractère réglementaire du contrôle du juge administratif ([53]) ([54]). Néanmoins, la juridiction administrative et, ce, depuis le 23 décembre 1981, a admis les exceptions d’illégalités contre les décrets à caractère général ([55]). Quoi qu’il en soit, cette limitation reste insuffisante puisque le contrôle par voie d’exception n’intervient que ponctuellement et ne fait qu’écarter l’application du règlement à un cas d’espèce, sans le radier de l’ordonnancement juridique. En outre, cette jurisprudence n’a, à notre connaissance, jamais été confirmée.
Et en dépit de cette absence de contrôle par voie d’action des actes réglementaires du président de la République, la distribution du pouvoir normatif entre l’exécutif et le législatif va être gravement altérée par la révision constitutionnelle de 1997. Désormais, la compétence de la chambre des députés va devenir une compétence d’attribution strictement limitée. L’alinéa 3 du nouvel article 35 de la Constitution octroie au président de la République la prérogative d’opposer « l’irrecevabilité de tout projet de loi ou d’amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. » et ce, à charge pour le Conseil constitutionnel de censurer l’empiétement éventuel du législateur. En somme, avec la réforme de 1997, et alors même que la loi votée par la chambre des députés est soumise à un contrôle — quand bien même précaire et sans véritable portée juridictionnelle — du Conseil constitutionnel, le pouvoir réglementaire du président de la République devient, quant à lui, total exclusif et sans contrôle.
Et à moins d’avoir un président de la République aux qualités d’ascète insoupçonnables, les prérogatives que l’actuelle Constitution tunisienne confère au chef de l’État ne peuvent qu’enivrer de puissance tout homme qui en disposerait. Cette ivresse du pouvoir nous amène à affirmer qu’il est humainement impensable qu’un président, jouissant de pareils pouvoirs, puissent à l’issue de la limite légale du nombre des mandats quitter le sommet de l’État. La Constitution tunisienne limite les mandats du président à trois. Ben Ali est en train d’achever son dernier mandat. L’agonie de la République en Tunisie s’achèvera, sans aucun doute, prochainement. Elle s’achèvera avec la prochaine réforme constitutionnelle qui abrogera la limite du nombre des mandats présidentiels. Les gesticulations du régime en ce sens ont déjà commencé. La présidence à vie, de fait ou de droit, semble désormais inévitable. Inévitable d’autant plus que la répression des démocrates tunisiens et la censure de leurs moyens d’expression se font dans la quasi indifférence de l’opinion publique internationale.
Riadh Guerfali (Astrubal)
Article publié en 2002 sous le pseudonyme de Chadly Ben Ahmed Al-Tûnisi, in “Horizons Maghrébins” n° 46/2002 : ”Réalités Tunisiennes : L’État de manque ; Politique, Économie, Société, Culture”. Presses Universitaires du Mirail, p. 27 à 37.
([1]) Le Hatti Humayoun à été publié par E. Engelhard dans le : La Turquie et le Tanzimât ou Histoire des réformes dans l’empire ottoman. Paris, Éd. A. Cotillon, 1882, p. 263 à 270. On trouve l’ouvrage d’E. Engelhard à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg sous la côte « D. 194 ».
([2]) – Très peu de temps après la promulgation du Hatti Humayoun, Mohammed Bey, en réponse aux pressions de l’Angleterre et de la France, adressera une lettre aux consuls des deux pays respectifs, dans laquelle il écrit : « Je te prie [sic] de faire connaître au gouvernement de sa Majesté (…) que je suis disposé à introduire dans mes États les réformes qui ont été successivement adoptées par la Sublime Porte, en les modifiant de façon à les rendre conformes à l’État et au besoin de mon pays ».
Cf. Hédia Khadhar : « “ Liberté, Égalité, Sécurité ”: Devise du Pacte Fondamental ». Page 167. In La révolution française et le Monde Arabo-Musulman. Actes du Colloque international organisé par la Société Tunisienne d’Étude du XVIII e siècle, Tunis 9-11 novembre 1989. Tunis, Les Éd. de la Méditerranée, p. 167 à 173.
([5]) – Cf. Béchir Tlili : Les rapports culturels et idéologiques entre l’Orient et l’Occident, en Tunisie, au XIX e siècle ( 1830-1880 ). Tunis, Publication de l’Université de Tunis, quatrième série : Histoire, vol. XIV, 1974, p. 529.
([6]) – I ) Une complète sécurité est garantie formellement à tous nos sujets, à tous les habitants de nos États, quelles que soient leur religion, leur nationalité et leur race. Cette sécurité s’étendra à leur personne respectée, à leurs biens sacrés et à leur réputation honorée.
Cette sécurité ne subira d’exceptions que dans les cas légaux dont la connaissance sera dévolue aux tribunaux ; la cause nous sera ensuite soumise, et il nous appartiendra soit d’ordonner l’exécution de la sentence, soit de commuer la peine, soit de prescrire une nouvelle instruction.
II ) Tous nos sujets sont assujettis à l’impôt existant aujourd’hui – ou qui pourra être établi plus tard – proportionnellement et quelle que soit la position de fortune des individus, de telle sorte que les grands ne seront pas exempts du Kanon à cause de leur position élevée et que les petits n’en seront point exempts non plus à cause de leur faiblesse. Le développement de cet article aura lieu d’une manière claire et précise.
III ) Les musulmans et les autres habitants du pays seront égaux devant la loi, car ce droit appartient naturellement à l’homme, quelle que soit sa condition.
IV ) Nos sujets israélites ne subiront aucune contrainte pour changer de religion, et ne seront point empêchés dans l’exercice de leur culte ; leurs synagogues seront respectées et à l’abri de toute insulte, attendu que l’état de protection dans lequel ils se trouvent doit leur assurer nos avantages comme il doit aussi nous imposer leur charge.
VIII ) Tous nos sujets, musulmans ou autres, seront soumis également aux règlements et aux usages en vigueur dans le pays : aucun d’eux ne jouira à cet égard de privilèges sur un autre.
([7]) – C’est une première Constitution depuis l’islamisation de la Tunisie. Car avant celle-ci, la Tunisie a connu une Constitution qui remonte à son histoire ancienne, en l’occurrence la Constitution de Carthage ( VII e siècle Avant J.-C. ). Dans son livre Le Politique, Aristote révèle le texte en question en le comparant avec les « Constitutions » spartiates de l’époque.
([8]) – Cf. Hachmi Jegham : La Constitution tunisienne de 1861. Tunis, éd. Chems-Tunis, 1989, page 59.
([9]) – Art. 86 : Tous les sujets du royaume tunisien, à quelque religion qu’ils appartiennent, ont droit à une sécurité complète quant à leurs personnes, leurs biens et leur honneur ainsi qu’il est dit à l’article premier du Pacte Fondamental.
Art. 88 – Tous les sujets du royaume, à quelque religion qu’ils appartiennent, sont égaux devant la loi, dont les dispositions sont applicables à tous indistinctement, sans avoir égard ni à leur rang, ni à leur position.
Art. 89 – Tous les sujets du royaume auront la libre disposition de leurs biens et de leurs personnes. Aucun d’eux ne pourra être forcé de faire quelque chose contre son gré, si ce n’est le service militaire, dont les prestations sont réglées par la loi. Nul ne pourra être exproprié que pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité.
Art. 105 – Une liberté complète est assurée à tous les étrangers établis dans les États tunisiens quant à l’exercice de leurs cultes.
Art. 109 – Ainsi qu’il a été promis aux sujets Tunisiens il est garanti aux étrangers établis dans le royaume une sûreté complète pour leurs biens de toute nature et pour leur honneur, ainsi qu’il est dit aux chapitres III et IV de l’Explication du Pacte Fondamental.
Art. 114 – Les créatures de Dieu devant être égales devant la loi, sans distinction, soit à cause de leur origine, de leur religion ou de leur rang, les sujets étrangers établis dans nos états, et qui sont appelés à jouir des mêmes droits et avantages que nos propres sujets, devront être soumis, comme ceux-ci, à la juridiction des divers tribunaux que nous avons institués à cet effet.
([10]) – Pour une analyse de la Constitution en question voir : Hachmi Jegham : La Constitution tunisienne de 1861. Op. cit.
([11]) – Cf. Le texte du décret beylical du 29 décembre 1955 dans A. Amor et K. Saïd : Textes et documents politiques tunisiens.. Tunis, C. E. R. P-Faculté de droit et de Science Économique, 1987, p. 103 et 104.
([12]) – Ce qui évidemment ne préjuge ni des arrières pensées ni des déclarations isolées qui ont pu avoir lieu à ce sujet.
([13]) Cf. Abdelfattah Amor : «Al-Majliss-el-qawmî al-ta’sîsi 1956-1959 » ( L’Assemblée Nationale Constituante ). Page 32. In El Majles el qaoumii ettaasissi . Actes du coll. du 29-31 mai 1984, Tunis, C. E. R. P-Faculté de droit et de Science Économique , 1986, p. 21 à 32.
([15]) – Cf. le texte de la résolution in A. Amor et K. Saïd : Textes et documents politiques tunisiens. Op. cit., p. 180.
([16]) – Cf. — Abdelfattah Amor : « Al-Majliss-el-qawmî al-ta’sîsi 1956-1959 » ( L’Assemblée Nationale Constituante ). Op. cit.
— Yadh Ben Achour : « Rapport final » du colloque relatif à l’Assemblée Nationale Constituante. Op. cit. p. 219.
— Youssef Hassen : « La résolution de L’Assemblée Nationale Constituante du 25 juillet 1957 ». In Revue Tunisienne de Droit, 1994, p. 251 à 265.
([17]) – Voir dans le même sens Abdelfattah Amor : « Al-Majliss-el-qawmî al-ta’sîsi 1956-1959 » ( L’Assemblée Nationale Constituante ). Op. cit. p. 32.
([18]) – Les « putschistes » et à leur tête Bourguiba n’utilisèrent pas l’argument de l’instauration d’un nouvel ordre de légalité pour justifier le coup d’État mais des arguments fondés sur une nouvelle interprétation du droit. Le premier président de la République, soucieux probablement de son image d’homme d’État légaliste, expliqua, très maladroitement d’ailleurs, que l’abolition de la monarchie s’est effectuée non pas en vertu d’une nouvelle légalité mais dans la continuité du droit en vigueur, puisque l’abolition du beylicat -avait-il affirmé-, a eu lieu « dans le cadre de la loi […] et conformément au droit en vertu duquel l’Assemblée constituante a été élue » . Extrait du discours du 25 juillet 1957 ( en arabe ) ; extrait cité par A. Amor, op. cit. p. 32.
([19]) – Par un judicieux découpage électoral et un mode de scrutin ( majoritaire ) qui ne laissaient aucune chance aux opposants du Néo-Destour, les élections vont assurer la victoire de 98 constituants néo-destouriens sur 98. Cf. Rafaa Ben Achour : « L’élection de l’Assemblée Nationale Constituante et sa composition ( en arabe ) ». In Al-Majliss-el-qawmî al-ta’sîsi. Actes du coll. du 29-31 mai 1984, Tunis, C. E. R. P-Faculté de Droit et des Sciences Économiques , 1986, p. 33 à 81.
Voir également Charles Debbasch : « L’Assemblée nationale constituante tunisienne ». In Revue Juridique et Politique d’Outre-Mer. 1959, n° 1, janvier-mars, p. 32 à 54.
([20]) – Cf. Charles Debbasch : La République tunisienne. Paris, L. G. D. J., 1962, p. 45. Cité par Mohamed Ridha Ben Hammed : Les pouvoirs exécutifs dans les pays du Maghreb ( Étude comparative ). Tunis, C.E.R.P, 1995, p. 34.
([21]) – Loi constitutionnelle n° 65-23 du 1er juillet 1965, J. O. R. T n° 35 du 2 juillet 1965, p. 825.
Loi constitutionnelle n° 67-23 du 30 juin 1967, J. O. R. T n° 27 des 27 et 30 juin 1967, p. 840.
Loi constitutionnelle n° 69-63 du 31 décembre 1969, J. O. R. T n° 57 des 30 et 31 décembre 1969, p. 1500.
Loi constitutionnelle n° n°75-13 du 19 mars 1975, J. O. R. T n° 9 des 18 et 21 mars 1975, p. 520.
Loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, J. O. R. T n° 26 des 9 et 13 avril 1976, p. 858.
Loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, J. O. R. T n° 40 du 12 juin 1981, p. 1391.
Loi constitutionnelle n° 81-78 du 9 septembre 1981, J. O. R. T n° 56 des 8 et 11 septembre 1981, p. 2091.
Loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, J. O. R. T n° 50 du 26 juillet 1988,p. 1066.
Loi constitutionnelle n° 93-105 du 8 novembre 1993, J. O. R. T n° 86 du 12 novembre 1993, p. 1899.
Loi constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre 1995, J. O. R. T n° 90 du 1 0 novembre 1995, p. 2095.
Loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997, J. O. R. T n° 87 du 31 octobre 1997, p. 1967.
Loi constitutionnelle n° 98-76 du 2 novembre 1998, J. O. R. T n° 89 du 06 novembre 1998, p. 2180.
Loi constitutionnelle n° 99-52 du 30 juin 1999, J. O. R. T n° 53 du 2 juillet 1999, p. 1063.
([27]) – Pour une approche approfondie du régime qu’institue la Constitution de juin 1959, cf.:
– Abdelfattah Amor : Le régime politique tunisien. Thèse, Paris, 1973.
– Charles Debbasch :- La République tunisienne. Paris, L. G. D. J., 1962.
– « La Constitution de la République tunisienne du 1er juin 1959 ». In Revue Juridique et politique d’Outre-Mer, Vol. XV, n°1, p. 145 à 155.
([29]) – Signalons qu’à l’indépendance, il n’était pas question de faire du Parti Socialiste Destourien un parti unique. La première Constitution tunisienne, bien que ne mentionnant nul part le multipartisme, devait en toute logique l’engendrer en raison des libertés et droits fondamentaux qu’elle garantissait, notamment dans son article 8.
([31]) – Cf. l’article 17 du statut du p. S. D. Ledit statut a été publié par Abdelfattah Amor et Kaïs Saïd : Textes et documents politiques tunisiens. ( En arabe). Tunis, C. E. R. P., 1987, p. 425 à 438.
([33]) – Extrait du discours du 8 juin 1970 à Tunis. In Habib Bourguiba, citations choisies par l’agence Tunis-Afrique-Presse. Tunis, Édition Dar-El-Amal, 1978, p. 85 et 86.
([34]) – Titre officiel et non moins constitutionnel du premier président de la République (cf. l’article 39 de la Constitution dans sa rédaction de 1975 )
([36]) – Nous en convenons… que le successeur fut Ben Ali , que la déclaration fut celle du 7 novembre 1987 qui brillait par son esprit démocratique, que le cadre géographique fut celui de la Tunisie, si toutefois cette suite d’événements est une nouveauté pour les Tunisiens, elle n’a en revanche, sur la forme, rien d’exceptionnel sur le plan des événements internationaux.
Que le successeur soit Pinochet, Jarouselki, Chadli, de Gaulle, Ben Ali etc, que cette succession soit le fruit d’une révolution, d’un coup de force ou d’une destitution constitutionnelle, le contenu des déclarations est toujours similaire : davantage de liberté et de démocratie. Dans ce contexte donc, les déclarations, y compris celles du 7 novembre, ne sont qu’un élément de la procédure destinée à appuyer la prise du pouvoir. Somme toute, l’unique différence entre ces nouveaux Chefs d’État, c’est que certains se révéleront comme de prestigieux Présidents admirés par les générations futures, alors que d’autres ne seront que des potentats dénoncés à travers l’histoire. Aussi, la déclaration de Ben Ali n’a rien d’exceptionnel et, autant dire, lorsque Ben Ali affirme dans sa déclaration que le peuple tunisien « a atteint un tel niveau de responsabilité et de maturité que tous ses éléments et ses composantes sont à même d’apporter leur contribution constructive à la gestion de ses affaires […] » certains Tunisiens éprouvent le sentiment du déjà entendu, tel dans la déclaration du Bey publiée trente années auparavant par « Le Petit Matin » du 30 décembre 1955 et dans laquelle il proclamait également que « […] le peuple tunisien avait atteint un degré de maturité qui le rendait apte à assumer toutes les responsabilités dévolues aux peuples libres et majeurs […] ». Là encore la déclaration du bey faisait suite à une [re-]accession au pouvoir à l’issue de l’acquisition de l’autonomie interne. Durant cette période le Bey également avait besoin de consolider et de relégitimer son pouvoir en promettant à ses sujets la démocratie. Aussi, dans ce contexte la déclaration du 7 novembre 1987 n’innovait nullement en matière d’annonce démocratique. Toutefois, ce qui serait véritablement nouveau, c’est d’atteindre les objectifs de ce type de déclaration : une réelle démocratie politique.
([37]) – L’article 57 de la Constitution disposait : « en cas de vacance de la présidence de la république pour cause de décès, démission ou empêchement absolu, le premier ministre est immédiatement investi des fonctions du président de la République pour la période qui reste de la législature en cours de la Chambre des députés […] ».
([38]) – Pour une analyse comparée à propos de la destitution de Bourguiba voir :
– L’Actiondu 8 novembre 1987, L’Action du 9-11- 87 et du 10-11-87 ( quotidien du p. S. D ).
– Le Monde : lundi 9 novembre 1987, p. 1, 3, 4, 5 ; mercredi 11 novembre 1987, vendredi 13-11-87,p. 8 ; samedi 14-11-87, p. 8 et jeudi 19-11-87,p. 6.
– L’Expressinternationaldu20 novembre 1987 n° 1997, p. 14 à 17 ( hebdomadaire indépendant international ).
– Jeune Afrique du 18 novembre 1987, n° 1402, p. 26 à 63 ( hebdomadaire indépendant international )
– Dialogue du 9 novembre 1987, n° 684 , p. 3 à 13 ( hebdomadaire du p. S. D. )
– Dialogue du 16 novembre 1987 n° 685, p. 5 à 11.
([40]) – Conformément à l’article 39 de la Constitution, le président de la république tunisienne est élu pour un mandat de 5 ans. La révision constitutionnelle de 1975 a introduit un nouvel alinéa disposant qu’« À titre exceptionnel et en considération des services éminents rendus par le Combattant suprême Habib Bourguiba au peuple tunisien qu’il a libéré du joug du colonialisme et dont il a fait une Nation unie et un État indépendant, moderne et jouissant de la plénitude de sa souveraineté, l’Assemblée nationale proclame le président Habib Bourguiba président de la République à vie ».
([41]) – Cf. la loi constitutionnelle n° 88 – 88 du 25 juillet 1988. Discussion et adoption le 12 juillet 1988.
([42]) – Article 57 nouveau : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, démission ou empêchement absolu le président de la Chambre des députés est immédiatement investi des fonctions de président de la République par intérim pour une période variant entre 45 jours au moins et 60 jours au plus.
Il prête le serment constitutionnel devant la Chambre des députés ou, le cas échéant, devant le bureau de la Chambre des députés.
Le président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission.
Le président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l’article 46.
Durant cette période, il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
Durant cette même période, des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau président de la République pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau président de la République peut dissoudre la Chambre des députés et organiser des élections législatives anticipées, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 63 ».
([43]) – L’article 39 nouveau (3 e alinéa ) énonce à ce sujet que « Le président de la République est rééligible deux fois consécutives ». D’autre part, pour éviter les désagréments d’un président âgé, l’article 40 nouveau a disposé que « [Le candidat doit] être le jour du dépôt de la candidature, âgé de 40 ans au moins et de soixante-dix ans au plus […] ». Concernant la limitation des mandats présidentiels, le nouvel article 39 se rapproche, en fait, des dispositions de l’article 40 de la Constitution telle que promulguée en 1959 ; et lesquelles limitaient la réélection du Chef de l’État à trois réélections consécutives.
([45])– Article 60 (ancien ) de la Constitution : « Le premier ministre dirige et coordonne l’action du gouvernement. Il dispose de l’administration et de la force publique, il supplée le cas échéant le président de la République dans la présidence du conseil des ministres ou tout autre conseil ».
– Article 60 ( nouveau ) de la Constitution : « le premier ministre dirige et coordonne l’action du gouvernement. Il supplée le cas échéant le président de la République dans la présidence du conseil des ministres ou tout autre conseil ».
([46]) – Au demeurant, H. Djaït fut, à notre connaissance, l’un des rares intellectuels tunisiens à le faire.
([47]) – Observons que cette saisie du journal « Réalitées » explique, à elle seule, la chape de silence qui a entouré l’aspect décrit de la révision constitutionnelle.
([48]) – Loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997, J. O. R. T n° 87 du 31 octobre 1997, p. 1967.
([50]) – Citons les exemples du Maroc et de l’Algérie, lesquels, à l’image de la France, scindent le pouvoir normatif en attribuant à l’exécutif un pouvoir réglementaire autonome ( art. 34 et 37 de la Constitution française, articles 46 et 47 de la Constitution marocaine et articles 122 et 125 de la Constitution algérienne ).
([51]) – Loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
([52]) – Sur la même question du pouvoir réglementaire en Tunisie cf. M. Ridha Ben Hammed, Les pouvoirs exécutifs dans les pays du Maghreb ( Étude comparative ). Tunis, 1995, C.E.R.P., p. 58 à 63.
([53]) – Article 3 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 : « Le Tribunal administratif est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre tous les actes des autorités administratives […]. Toutefois, ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir les décrets à caractère réglementaire ».
([54]) – Cf. Mohammed Salah Ben Aïssa : « La compétence du tribunal administratif en matière de recours pour excès de pouvoir et d’appel ». Page 217. In L’œuvre jurisprudentielle du tribunal administratif tunisien. Collectif, sous la direction de Sadok Belaïd, Tunis, c.e.r.p., 1990, p. 213 à 295. Voir également R. Ben Achour : « Les protections et les garanties constitutionnelles des droits et libertés en Tunisie ». Page 65. In Revue Tunisienne de Droit, 1989, p. 57 à 69.
([55]) – Cf. arrêt Bouraoui/Ministre de l’Enseignement supérieur du 23 décembre 1981. Cité par Yadh Ben Achour : Droit administratif. Tunis, 1982, p. 474-475. Cité par Mohamed Salah Ben Aissa : « La compétence du tribunal administratif en matière de recours pour excès de pouvoir et d’appel ». Page 289. In L’œuvre jurisprudentielle du tribunal administratif tunisien. Collectif, sous la direction de Sadok Belaïd, Tunis, C.E.R.P., 1990, p. 213 à 295.


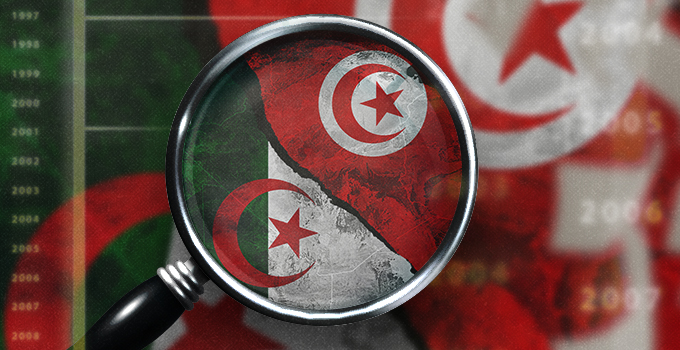

iThere are no comments
Add yours